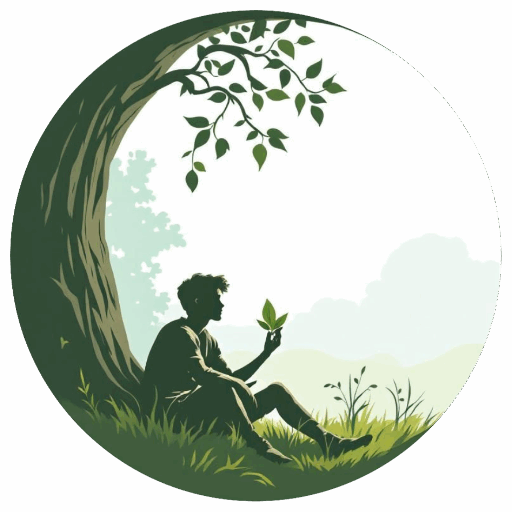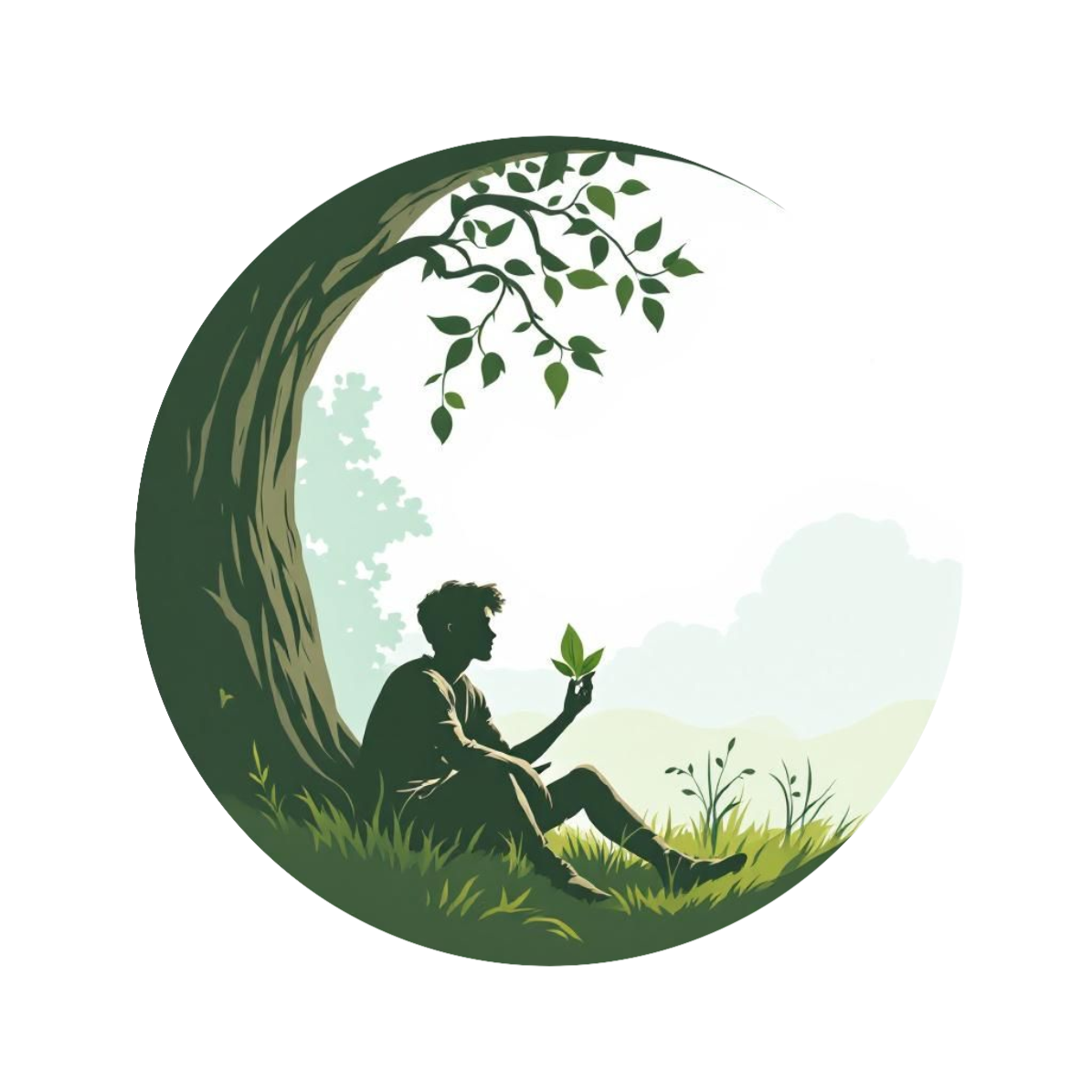Vous avez déjà croisé cet arbre dans les cimetières ou les parcs. Il s’agit de l’if commun (Taxus baccata), un conifère non résineux de la famille des Taxacées, caractérisé par une croissance lente et une longévité exceptionnelle pouvant dépasser 1 500 ans. En France, il n’existe pas d’autres espèces indigènes de cette famille. Il est assez rare à l’état sauvage, puisqu’il était souvent détruit à cause de sa toxicité pour le bétail et les équidés. Il est toutefois très présent dans les parcs où il fut planté au XVIIe et au XVIIIe siècle.
Le nom du genre illustre bien l’usage que l’on faisait du bois des ifs. Taxus signifie arc en latin. On utilisait en effet son bois remarquable pour confectionner des arcs. Baccata en latin signifie « fait avec des perles« , en référence à la forme de la partie rouge qui est un arilleStructure spécialisée, souvent charnue et colorée, qui entoure partiellement ou totalement la graine de certaines plantes.. Quant à son nom français, il provient du gaulois ivos (if en gaulois). Ce mot gaulois est issu d’un étymon celtique qui se retrouve en breton (ivin) ou en gallois (ywen).1
Description de l’if commun
L’if commun est une espèce sciaphileSe développe de préférence à l'ombre ou dans des conditions de faible luminosité.. Il prospère en sous-bois de hêtraies-sapinières ou de chênaies calcaires, jusqu’à 1 600 m d’altitude en moyenne. Il présente un port conique dense lorsqu’il est jeune, évoluant vers une silhouette irrégulière avec le temps. Il atteint généralement 10 à 25 mètres de hauteur à maturité.


Son écorce, initialement lisse et rougeâtre, se fissure en plaques écailleuses avec le temps, révélant des teintes brun pourpre.




Les feuilles de l’if commun sont disposées en spirale, mais semblent souvent disposées en deux rangées à cause de la torsion de leur base. Elles sont linéairesQualifie un organe étroit et allongé à bords parallèles. et mesurent entre 15 et 35 mm de long. Leur face supérieure est vert foncé lustré, tandis que la face inférieure présente deux bandes plus claires et peu visibles.

La reproduction de l’if repose sur des structures sexuées distinctes : les chatons mâles, globuleux et jaunâtres, libèrent un pollen anémophileLa pollinisation est assurée par le vent. Ces plantes ont souvent des fleurs peu colorées et peu parfumées, car elles ne cherchent pas à attirer les pollinisateurs..
Les fleurs femelles sont réduites à un ovule unique. Il produit une graine toxique enveloppée par un arilleStructure spécialisée, souvent charnue et colorée, qui entoure partiellement ou totalement la graine de certaines plantes. charnu rouge vif, seul élément comestible de la plante. Contrairement aux vrais fruits qui proviennent de l’ovaire d’une fleur, l’arilleStructure spécialisée, souvent charnue et colorée, qui entoure partiellement ou totalement la graine de certaines plantes. est une excroissance de la graine elle-même. Et on ne peut l’appeler fruit puisque l’if n’est pas une Angiosperme mais une Gymnosperme. Disséminées par les oiseaux qui consomment l’arilleStructure spécialisée, souvent charnue et colorée, qui entoure partiellement ou totalement la graine de certaines plantes., les graines germent après une dormance nécessitant une stratification froide, processus pouvant s’étendre sur 18 mois.




Je trouve que l’arilleStructure spécialisée, souvent charnue et colorée, qui entoure partiellement ou totalement la graine de certaines plantes. a un très bon goût, et une texture assez rafraichissante. Si vous souhaitez goûter, ne croquez pas la graine et recrachez là. En général, la consommation de graines non mastiquées n’entraîne pas de conséquences. J. Bruneton rapporte que 90 % des enfants qui avalent les arillesStructure spécialisée, souvent charnue et colorée, qui entoure partiellement ou totalement la graine de certaines plantes. sans mâcher les graines ne ressentent aucun symptôme.2
Veillez aux personnes qui vous entourent. Si l’on vous observe (notamment dans les parcs), prenez le temps d’expliquer que seul l’arilleStructure spécialisée, souvent charnue et colorée, qui entoure partiellement ou totalement la graine de certaines plantes. rouge est comestible et que toutes les autres parties de l’arbre sont extrêmement toxiques.
Avec beaucoup de patience, il est même possible de préparer de la gelée d’arilleStructure spécialisée, souvent charnue et colorée, qui entoure partiellement ou totalement la graine de certaines plantes.. La marche à suivre est disponible sur le site Garrigue gourmande.

Voyons maintenant les raisons pour lesquelles nous considérons l’if commun comme une plante extrêmement toxique.
Les effets de la consommation de l’if commun
Nous l’avons vu, toutes ses parties, à l’exception de l’arilleStructure spécialisée, souvent charnue et colorée, qui entoure partiellement ou totalement la graine de certaines plantes. charnu, sont toxiques. Les intoxications humaines et animales entraînent des troubles cardiaques sévères, avec un taux de létalité élevé en l’absence de traitement rapide. La toxicité de l’if s’explique par la présence d’alcaloïdes cardiotoxiques.
Les taxines : principaux agents toxiques
L’if commun produit un mélange complexe d’alcaloïdes diterpéniques, regroupés sous le terme de taxines. La taxine B et son isomère, l’isotaxine B, sont les composés les plus toxiques. Ces molécules inhibent les canaux sodiques et calciques des cardiomyocytes, perturbant la conduction électrique et la contractilité cardiaque. Cette action duale explique l’apparition d’arythmies ventriculaires et de blocs de conduction, conduisant à un arrêt cardiaque réfractaire.
D’autres espèces d’ifs présentent également une toxicité similaire, à l’instar de l’if du Japon (Taxus cuspidata). Les hybrides ornementaux, tels que (Taxus x media), sont également dangereux.4
Intoxications et décès liés à la consommation des ifs (Taxus spp.)
Les intoxications par les ifs résultent majoritairement de l’ingestion de feuilles ou de graines, souvent dans un contexte suicidaire ou par méconnaissance de leur toxicité.
L’ingestion de feuilles entraîne une symptomatologie grave en moins d’une heure : vomissements, douleurs abdominales, puis troubles de conscience précèdent les complications cardiorespiratoires.
Je vais présenter quelques exemples cités dans la publication de Jean Bruneton, professeur de pharmacognosie à la faculté de pharmacie d’Angers et spécialiste de phytochimie.
Suicide en Serbie (2018)
Une femme de 30 ans a été retrouvée morte avec des feuilles d’if dans l’estomac. L’analyse toxicologique a identifié du 3,5-diméthoxyphénol (marqueur de dégradation de la taxicatine) dans le sang et les organes, confirmant l’intoxication. Ce composé, bien que non spécifique aux ifs, reste un indicateur préliminaire utile en médecine légale.2
Décès aux États-Unis (2023)
Une femme de 38 ans en Oregon a succombé après avoir ingéré une infusion de feuilles de Taxus brevifolia. Malgré les défibrillations et l’injection intra-osseuse de médicaments, le décès est survenu 30 minutes après l’arrivée des secours, illustrant la rapidité de l’action toxique.2
Cas en Autriche (2022)
Un homme de 39 ans en institution psychiatrique a ingéré 30 g de tiges et feuilles, provoquant un choc cardiogénique. Après 40 minutes de réanimation et 39 heures sous oxygénation par membrane extracorporelle, il a survécu sans séquelles neurologiques, démontrant l’efficacité des techniques d’assistance circulatoire.2
Intervention en Suisse (2019)
Une adolescente ayant consommé des feuilles d’if a présenté un arrêt cardiaque. Une réanimation incluant électrostimulation et divers médicaments a permis un rétablissement complet en 6 heures.2
Mésusage thérapeutique en Italie (2018)
Trois membres d’une famille ont ingéré une infusion de feuilles d’if, croyant à des propriétés anticancéreuses. Ils ont développé des tachycardies ventriculaires traitées par lidocaïne et bicarbonate de sodium, avec récupération après plusieurs jours de soins intensifs.2
Erreur alimentaire au Portugal (2021)
Une étudiante a accidentellement consommé des feuilles, entraînant une bradycardie sévère et une tachycardie ventriculaire. L’administration d’atropine, de dopamine et de fragments Fab a stabilisé son état en quelques heures.2
Cas pédiatrique au Royaume-Uni (2023)
Une fille de 13 ans a ingéré un smoothie aux feuilles d’if, provoquant un arrêt cardiaque. La mise sous oxygénation par membrane extracorporelle et l’administration de lévosimendan ont corrigé le dysfonctionnement biventriculaire, permettant une sortie sans complications.2
L’if est aussi toxique pour les animaux
Les chevaux sont particulièrement vulnérables et succombent à des doses de 0,5 à 2 g de feuilles/kg.3 ; 5 Soit l’équivalent de 100-200 g pour un individu de 500 kg. Les animaux sauvages comme les cerfs montrent une résistance, attribuée à des adaptations métaboliques évolutives.
Le bois de l’if : une essence aux propriétés exceptionnelles
Le bois de l’if est extrêmement réputé du fait de ses propriétés. Contrairement à la plupart des essences, la différence de dureté entre le bois initial (printanier) et final (estival) reste minime, conférant une homogénéité structurale exceptionnelle. Cette particularité explique sa remarquable élasticité.
La densité du bois, comprise entre 600 et 750 kg/m³, résulte d’une imprégnation optimale de lignine, cette substance polymère qui rigidifie les parois cellulaires. Cette densité élevée, associée à une absence de canaux résinifères, lui confère une résistance à la compression évaluée à 54 N/mm², tout en maintenant une certaine souplesse.
C’est la raison pour laquelle les arcs en if des archers gallois et anglais étaient réputés. La structure composite naturelle du bois, combinant un aubier flexible et un duramen résistant à la compression, permettait de stocker une énergie élastique supérieure à 100 joules. Un arc de 1,80 m en if pur pouvait projeter des flèches à plus de 200 mètres.
Cette demande militaire entraîna une surexploitation dramatique. Les forêts anglaises d’if furent décimées au XIVe siècle, obligeant à importer du bois d’Autriche et d’Europe de l’Est. Le Parlement britannique promulgua même des lois au XVe siècle pour protéger les rares spécimens restants, préfigurant les premières mesures de conservation arboricole.
Les risques de confusion
Lorsqu’on souhaite consommer les feuilles d’un conifère à l’instar du pin sylvestre (Pinus sylvetris), il ne faut en aucun cas le confondre avec l’if commun, et s’abstenir en cas de doute ! Pour faire bref, vous pouvez retenir que l’if commun ne produit pas de résine. Vous ne trouverez donc pas de résine sur son tronc et les feuilles ne dégagent aucune odeur au froissement.
Si vous êtes malade ou avez un problème d’odorat, il faudra faire preuve de vigilance et s’abstenir au moindre doute. Je vais vous présenter un exemple avec l’épicéa commun (Picea abies).
If commun ou épicéa ?
Les feuilles de l’épicéa, rigides et légèrement piquantes avec une section carrée, rayonnent autour du rameau. Elles ne présentent pas de bandes sur leur face inférieure. Tandis que celles de l’if, molles et plates, sont disposées en spirale mais semblent souvent disposées en deux rangées à cause de la torsion de leur base. Elles sont linéairesQualifie un organe étroit et allongé à bords parallèles. et mesurent entre 15 et 35 mm de long. Leur face supérieure est vert foncé lustré, tandis que la face inférieure présente deux bandes plus claires.


Les cônes pendants et bruns de l’épicéa contrastent avec les arillesStructure spécialisée, souvent charnue et colorée, qui entoure partiellement ou totalement la graine de certaines plantes. rouges entourant les graines toxiques de l’if. Enfin, l’écorce écailleuse et rugueuse du premier s’oppose à la surface lisse et rougeâtre du second.


N’hésitez pas à participer à une sortie avec un animateur ou une association près de chez vous. Si vous résidez dans les Ardennes françaises, n’hésitez pas à consulter les prochaines dates.
Sources
1. Brentegani M. Plantes des celtes. Leduc Editions, Paris. 224 p.
2. Bruneton, J. Pharmacognosie, phytochimie, plantes médicinales. publié et mis à jour sur le site : https://www.phytomedia.fr/ifs. Consulté le 26 février 2025.
3. Centre Antipoisons belge ; L’if commun : https://www.centreantipoisons.be/nature/plantes/les-plantes-toxiques/if-taxus. consulté le 25 février 2025.
4. Centre anti-poison du CHU de Lille ; l’if commun : https://www.cap.chu-lille.fr/2021/01/26/if/. Consulté le 26 février 2025.
5. Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise Canadien ; Empoisonnement par l’if chez les chevaux et les ruminants : http://www.ontario.ca/fr/page/empoisonnement-par-lif-chez-les-chevaux-et-les-ruminants. Consulté le 26 février 2025.