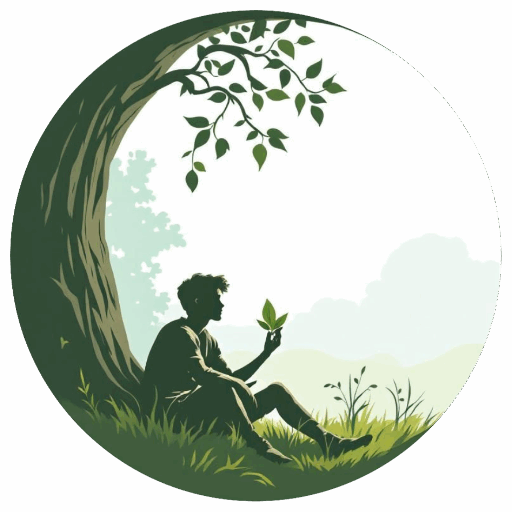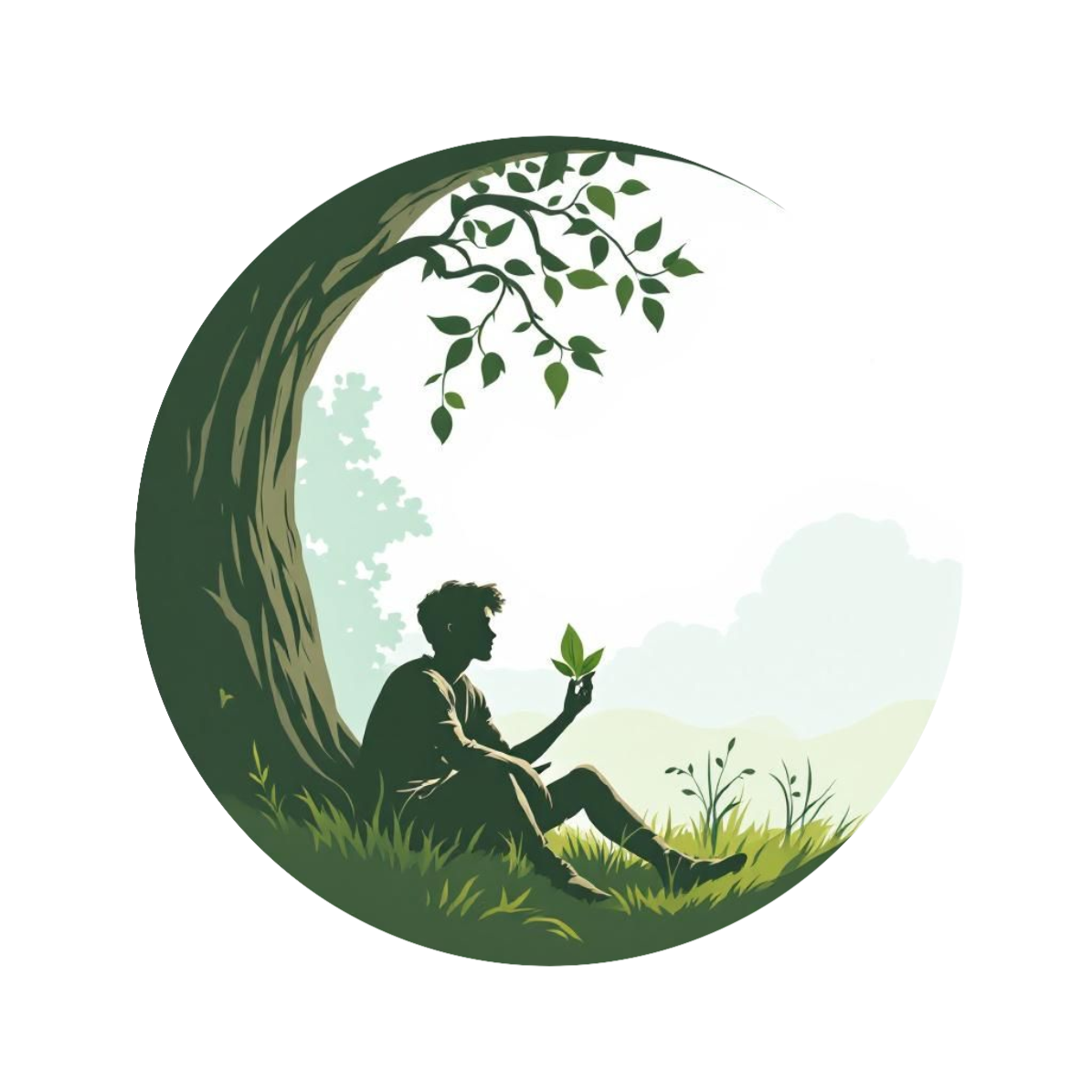Lorsqu’on pense au calcium, on l’associe généralement aux laitages. Cette association néfaste s’explique par notre éducation et le lobbying du lait. Pourtant, comme vous le découvrirez au cours de cet article, il existe de nombreuses plantes sauvages riches en calcium. Il ne s’agit pas de compléments alimentaires, mais bel et bien de plantes comestibles qui poussent à côté de chez vous. Vous n’avez pas besoin de consommer du lait ou du fromage pour renforcer vos os.
Dans cet article, vous découvrirez une sélection de plantes sauvages riches en calcium. J’expliquerai brièvement la notion de biodisponibilité avant de partager un tableau issu d’un ouvrage de référence.
Si vous recherchez des plantes sauvages riches en protéines, c’est par ici !
Mieux comprendre la richesse des plantes sauvages en calcium
Sans référence, les valeurs présentées ci-dessous peuvent être difficiles à appréhender. Retenez que le lait, qu’il soit entier, demi-écrémé ou écrémé, contient environ 120 mg de calcium pour 100 ml. Ce n’est pas du calcium pleinement assimilable, mais c’est un autre sujet.
Parmi les légumes cultivés, la laitue renferme 32 mg de calcium pour 100 g de feuilles fraîches ; la courgette, 15 mg pour 100 g ; l’aubergine 36 mg pour 100 g ; les oignons 20 mg pour 100 g.1
Les principales plantes sauvages riches en calcium
La grande ortie (Urtica dioica) : une plante riche en calcium
Je souhaite commencer par l’ortie parce qu’il s’agit de mon point de vue de la plante qui bénéficie d’un meilleur ratio entre son abondance et sa richesse en calcium. Avec une teneur moyenne de 630 mg pour 100 g de feuilles fraîches1, elle dépasse largement le lait de vache ou la laitue cultivée.
Une cuisson rapide à la vapeur ou un blanchissage permettent de neutraliser les poils urticants tout en préservant les nutriments. Florence Foucaut, diététicienne-nutritionniste, recommande notamment des associations culinaires stratégiques : « 200 g d’ortie fraîche pour 100 g de pommes de terre apportent un équivalent protéique comparable à une portion de viande, tout en optimisant l’apport calcique »2.
La grande ortie étant une plante vivacePlante pouvant vivre plusieurs années., vous la retrouverez au même endroit chaque année. Il suffit de la cueillir et de la faucher pour profiter à chaque fois de ses jeunes pouces. Vous pouvez très bien la sécher et la réduire en poudre au fur et à mesure pour enrichir vos mueslis, soupes ou préparations diverses. Vous profiterez ainsi d’une poudre nutritive riche également très riche en protéine.
L’autre avantage est que cette plante sauvage riche en calcium est très facile à reconnaître. Il n’y a d’ailleurs aucun risque de confusion avec une plante toxique.
Le pissenlit (Taraxacum officinale)
Autre plante facile à reconnaître et riche en calcium : le pissenlit. Il affiche une teneur en calcium de 473 mg pour 100 g de feuilles crues1. Ses propriétés diurétiques, longtemps mises en avant en phytothérapie, ne doivent pas occulter son potentiel nutritionnel.
Contrairement à une idée reçue, il est tout à fait possible de cueillir et de consommer les feuilles des pissenlits tout au long de l’année. Les jeunes feuilles sont certes agréables en bouche, mais gagnent en amertume avec le temps. Vous pouvez toutefois les blanchir ou les faire cuire. L’inconvénient du pissenlit est qu’il pousse proche du sol et sur des zones riches en matières organiques. Par chez moi, je ne peux malheureusement pas m’en faire des salades. Mais la cuisson permet d’éviter les parasites.
Les pissenlits renferment également une bonne quantité de potassium avec 590 mg pour 100 g de feuilles crues. Ils sont par ailleurs extrêmement riches en provitamine A avec une concentration de 14 000 UI pour 100 g.1
Le chénopode blanc (Chenopodium album)
Le chénopode blanc fait partie des mauvaises herbes les plus détestées. Pourtant, ses feuilles contiennent jusqu’à 370 mg de calcium pour 100 g, accompagnés de 920 mg de potassium et de 236 mg de vitamine C1. Cette combinaison rare optimise la biodisponibilité du minéral, avec une absorption estimée à 40-50 %, contre 30 % pour les épinards cultivés.
Contrairement à de nombreuses plantes sauvages, le chénopode blanc supporte bien la cuisson prolongée, ce qui permet de réduire sa teneur en acide oxalique sans dégrader significativement son contenu minéral. Ses graines, comestibles après trempage, apportent un supplément calcique intéressant.
Autres plantes sauvages riches en calcium
La grande mauve (Malva sylvestris)

Les feuilles de la grande mauves sont riches en calcium avec environ 690 mg pour 100 g.1 Ses fleurs sont également comestibles et renferment des anthocyanes aux propriétés anti-inflammatoires, potentiellement bénéfiques dans la prévention de l’ostéoporose post-ménopausique.
La berce spondyle (Heracleum sphondylium)
La berce spondyle, aussi appelée grande berce, est également une plante sauvage riche en calcium. Ses feuilles renferment 320 mg de calcium pour 100 g. Elles contiennent également 540 mg de potassium pour, 290 mg de vitamine C pour 100 g.1
Si vous la coupez, pensez à bien vous nettoyer les mains et à ne pas vous exposer au soleil. C’est une plante photosensibilisante, caractéristique des plantes de la famille des Apiacées.
La pâquerette (Bellis perennis) : une plante sauvage riche en calcium
Originaire d’Eurasie et pourtant connue de tous, la pâquerette est facile à reconnaître et est omniprésente. C’est une bonne plante bio-indicatrice puisque sa présence témoigne d’un sol en cours de décalcification ou en cours d’érosion. Sa résistance au piétinement et aux tontes fréquentes en fait une compagne constante des activités humaines.
Ses feuilles et ses capitules (les fleurs) renferment 190 mg de calcium pour 100 g, mais aussi 600 g de potassium et 87 mg de vitamine C pour 100 g.1 Vous souvenez-vous de la teneur en calcium du lait et de la laitue cultivée ? La différence est édifiante.
Les plantains sont riches en calcium
Autres plantes sauvages riches en calcium : les plantains. Vous les connaissez certainement puisqu’ils poussent aussi à proximité des activités humaines.
Les feuilles du grand plantain renferment 184 mg de calcium pour 100 g.1 Je vous invite à lire l’article complet dédié aux plantains si vous souhaitez en apprendre davantage.
Les interactions nutritionnelles
L’absorption du calcium végétal dépend étroitement de la présence de cofacteurs. La vitamine D, synthétisée sous l’effet des UVB améliore son assimilation intestinale de 30 à 80 %. À l’inverse, les phytates et oxalates présents dans de nombreuses plantes sauvages peuvent former des complexes insolubles. À titre d’exemple, le calcium de la grande ortie présente une biodisponibilité plus importante que le calcium de l’épinard cultivé. Ce dernier étant riche en oxalate, cela diminue son taux d’absorption par le corps.
Tableau : richesse des plantes sauvages en calcium
Voici un tableau extrait de l’ouvrage de référence ayant été utilisé pour rédiger cet article.
| Plante | Calcium (mg/100g) |
|---|---|
| Onagre (gr.) | 1422 |
| Amarante livide (f.) | 837 |
| Chénopode des murs (f.) | 737 |
| Mauve sylvestre (f.) | 690 |
| Ortie (f.) | 630 |
| Sisymbre (f.) | 495 |
| Amarante réfléchie (f.) | 476 |
| Pissenlit (f.) | 473 |
| Luzerne polymorphe (f.) | 440 |
| Galingosa (f.) | 410 |
| Chénopode blanc (f.) | 370 |
| Caroube (fr.) | 352 |
| Oxalis corniculée (f.) | 352 |
| Bident (f.) | 340 |
| Mauve à feuilles rondes (f.) | 324 |
| Berce (f.) | 320 |
| Tussilage (f.) | 320 |
| Morelle noire (f.) | 307 |
| Amande (gr.) | 266 |
| Figue sèche (fr.) | 265 |
| Cynorrhodon (fr.) | 257 |
| Navet sauvage (f.) | 250 |
| Menthe sylvestre (f.) | 241 |
| Moutarde noire (f.) | 220 |
| Bourse-à-pasteur (f.) | 210 |
| Noisette (gr.) | 210 |
| Épine-vinette séchée (fr.) | 205 |
| Cresson alénois (f.) | 200 |
| Cresson (pl.) | 195 |
| Menthe verte (f.) | 195 |
| Navet (f.) | 191 |
| Pâquerette (f.) | 190 |
| Plantain (f.) | 184 |
| Ail (p.s.) | 181 |
| Bistorte (f.) | 150 |
| Épilobe (j.p.) | 150 |
| Bec-de-grue (f.) | 140 |
| Chicorée (f.) | 140 |
| Raifort (p.s.) | 140 |
| Persil (f.) | 140 |
| Aubépine (f.) | 130 |
| Luzerne cultivée (f.) | 120 |
| Tournesol (gr.) | 120 |
| Betterave (f.) | 119 |
| Fenouil (f.) | 115 |
| Bon-Henri (f.) | 110 |
| Phytolaque (j.p.) | 103 |
| Pourpier (pl.) | 103 |
| Noix (gr.) | 100 |
| Épinard (f.) | 100 |
| Bourrache (f.) | 93 |
| Laiteron (f.) | 93 |
| Ciboulette (f.) | 90 |
| Hémérocalle (fl.) | 85 |
| Figue fraîche (fr.) | 83 |
| Haricot sec (gr.) | 83 |
| Armoise (f.) | 82 |
| Myrte (fr.) | 81 |
| Passerage (f.) | 80 |
| Stellaire (pl.) | 80 |
| Rumex crépu (f.) | 75 |
| Oseille (f.) | 66 |
| Châtaigne sèche (gr.) | 65 |
| Chrysanthème (f.) | 63 |
| Oponce (fr.) | 60 |
| Prêle (pl.) | 60 |
| Salsifis (p.s.) | 60 |
| Souchet (p.s.) | 60 |
| Poireau (f.) | 59 |
| Bardane (p.s.) | 58 |
| Cassis (fr.) | 55 |
| Panais (p.s.) | 55 |
(f.) : Feuilles
(gr.) : Graines
(pl.) : Plante entière
(p.s.) : Partie souterraine
(j.p.) : Jeunes pousses
(fl.) : Fleurs
(fr.) : Fruits
Sources
1. Couplan F. (2020) : Guide nutritionnel des plantes sauvages et cultivées, Delachaux et Niestlé, Lausanne.
2. Florence Foucaut « Les plantes sauvages apportent plus de nutriments que les aliments enrichis » : https://www.plantes-et-sante.fr/articles/rencontres/5041-florence-foucaut-les-plantes-sauvages-apportent-plus-de-nutriments-que-les-aliments-enrichis. Consulté le 7 mars 2025.